The Brutalist
Attention spoilers potentiels
The Brutalist ou la brutalité de l’envers de la liberté
The Brutalist, le point de vue du réalisateur Brady CORBET sur la religion, le capitalisme, la famille et la sexualité, mais aussi sur la subsidence (ici des camps de concentration) et sur la création (ici l’architecture).
Cette recension s’adresse tout d’abord au gens qui ont vu le film et dans l’intention de partager l’expérience.
La religion, notamment juive, mais aussi chrétienne, est présente tout au long du film. Brady CORBET semble nous dire au début qu’elle est essentielle, qu’elle permet de trouver des personnes « compatibles » quand nous sommes dans un environnement inconnu (si nous avons la chance qu’elle soit déjà présente sur ce lieu). Un peu plus loin, le réalisateur semble prendre de la distance lors d’un repas en famille, mais finalement pas tant que cela. Dans The Brutalist, les Juifs sont tolérés par les chrétiens en subissant des stigmatisations, notamment physiques, et, à l’instar de la femme du cousin Attila qui complote contre László et lui conseille de se faire refaire le nez, montrant du même coup la superficialité d’une société qui vous accepte si vous vous soumettez, à l’image d’Attila, intégré par un changement de nom et de religion. Le fils du très riche industriel Harrison Van BUREN qui profite de cette société chrétienne pour laisser s’exprimer un paquet de saloperies tout au long de l’histoire. Le film n’oublie pas de dépeindre les chrétiens comme étant ouvertement racistes :-), le réalisateur ne semble pas beaucoup aimer cette religion.
J’ai cru comprendre que Brady CORBET n’aime pas beaucoup les capitalistes non plus (peut-être parce que les uns sont soupçonnés d’être les fils de l’autre), qu’il décrit comme cyniques. Tout d’abord, la première expérience d’entreprise racontée par Attila, suivi de sa fausse humilité face à sa « réussite », puis encore Harry Van BUREN le fils d’Harrison qui, sûr de sa puissance (en réalité celle de son père), essaie de monnayer une bibliothèque, et sa stupidité quand László lui fait un devis qui semble extravagant mais qu’Harry accepte. Puis l’arrivée du père raciste et violent. Que dire des industriels qui exploitent la misère sur le port en faisant faire des taches dangereuses à des humains qui ne peuvent qu’accepter pour survivre. Le père Van BUREN, Harrison riche industriel flaire le bon coup et fait preuve de « charme » quand il s’aperçoit du potentiel de l’ouvrier (László)qu’il a humilié précédemment, Le même Van BUREN racontant avec suffisance le cynisme dont il a fait preuve avec ses grands-parents, se dévoilant à László, qui, du coup, devrait savoir à quoi s’en tenir. Mais comment être réaliste quand vous êtes extrait brutalement de la misère et que vous vous retrouvez au centre de l’attention au milieu d’un luxe oublié, voire inconnu de vous, le capitalisme vous prévient en vous aveuglant, quelle chance avons-nous ? N’oublions pas la duplicité quand il s’agit d’argent : Harrison Van BUREN fait croire qu’il est au-dessus des contingences capitalistes en se faisant passer pour un intellectuel cultivé (d’ailleurs rapidement mis à jour par Erzsébet dans la voiture qui les emmène à la « grande ville ») mais aussi par le réalisateur qui fait disparaître tous les livres dans le film, pourtant de « première édition » (et moqué par cet arriviste d’Attila, qui démontre, là, un réalisme surprenant) de la bibliothèque conçue par László.
Histoires de familles. László retrouve le cousin de sa femme, marié et intégré à Philadelphie, d’abord avenant et généreux, mais sans excès ; il va vite montrer sa soumission aux codes sociaux locaux et surtout à sa femme, sans laisser une chance à László qui, réaliste, n’essaie même pas de s’expliquer. Puis un Gordon protecteur et son fils qui, à mon avis, mériteraient un film à eux seuls. La famille Van BUREN, avec la mère mourante, objet de toutes les attentions de son fils, ses propres jumeaux, dont le fils n’hésite pas à jouir de la puissance de son père comme si c’était lui qui était désormais responsable de tout (un clin d’œil aux chefs d’entreprises qui se sont « fait tout seuls » en nous faisant croire qu’ils sont partis de rien), fils qui n’hésite pas à dénigrer son père en public avec l’accord tacite de celui-ci, qui ne le reprend pas. Un des jumeaux est décrit comme cynique et prétentieux, quand la fille, Maggie, est généreuse et gentille. Le couple d’avocats, à l’instar de Gordon et son fils qui sont, étrangement dans ce film, dépeints comme honnêtes et serviables, un hommage subtil à la justice ? Erzsébet et Zsófia sa nièce qu’elle a protégée malgré les entraves que cela causait. CORBET nous propose donc trois types de famille dans ce film : 1) la famille créée de toute pièce pour s’intégrer, 2) la famille comme une entreprise et 3) la famille choisie.
Inceste, impuissance, viol, pulsions et amour. Une des premières scènes du film est celle des prostituées, sexe tarifé qui ne mène à rien. La suggestion d’inceste entre les jumeaux derrière la porte du manoir. Attila prêt à céder sa femme pour la frime. Sensualité dans les clubs de jazz. Un cinéma porno comme refuge après une nuit de débauche. Difficulté des rapports fantasmés face à la réalité : la branlette prodiguée par Erzsébet à László juste après leurs retrouvailles. Sensualité et fidélité à une fête en Italie dans les carrières d’un marbre de Carrare séculaire. Puis le viol. Le viol qui, pour moi, fait basculer le film. Un film qui bascule jusqu’à atteindre son acmé dans la scène d’amour entre et László. le dur chemin du viol à l’amour. Un shoot d’héroïne à sa femme pour calmer ses douleurs: la drogue comme un miracle permettant l’amour et la révélation, cette même drogue qui avait été présentée comme une déchéance qu’il fallait arrêter (Gordon). Mais je n’oublie pas la suggestion du viol de la « fragile » nièce par Harry, le fils de Harrison. Je n’oublie pas non plus l’autre suggestion du rapport incestueux entre Harry et Harrison, les prénoms résonnant cruellement.
J’ai aimé ce film, il montre la douleur que peut éprouver une personne qui a subi un trauma. Double peine : dans ce film, László a subi les camps de concentration et, en écho lointain, le viol d’un capitaliste sans scrupules. Voir même triple peine, son nez, personnifiant le judaïsme, la judéité, le fait tomber dans la déchéance de la drogue, avant qu’elle ne devienne l’instrument de sa rédemption. (je regrette j’ai oublié la scène ou il se casse le nez point de départ du fil rouge du film : l’héroïne). Il montre, aussi, que l’intelligence n’évite pas la misère et qu’elle ne peut pas grand-chose face à la duplicité du capitalisme, mais, dans cette histoire, l’intelligence et la patience de László lui permettront de s’en venger : Le centre communautaire en hommage à la mère d’Harrison deviendra, à l’insu de celui-ci, un écho des camps de concentration, plus précisément des camps où László et Erzsébet ont été internés (cette décision de László semble suggérée avec la scène où il envisage de réfléchir à l’assemblage de poutres et verrières). En passant, dans ce film, le réalisateur nous montre que, lors de coupes budgétaires, c’est la culture qui saute en premier avec la suppression de la bibliothèque : le capitalisme n’a pas besoin de gens cultivés, mais de gens forts et croyants. Mais revenons au centre communautaire voulu par Harrison et soutenu par la société locale chrétienne, transformé en métaphore de camps de concentration par la vengeance d’un architecte, Harrison ignorera sans doute la vraie raison d’être du centre communautaire et de ces labyrinthes, métaphore des sentiments complexes qui permettent à l’amour de se retrouver (la symbolique de l’eau recueillie dans les fondations ?).
Ce film est plein de non-dits, de suggestions et de pistes qui peuvent être agaçantes, mais qui sont du ressort du réalisateur et de ses choix créatifs ( ?), un peu comme les suggestions de transformation des tracés du centre communautaire par un architecte sans talent piloté par un fils somme toute bestial et ignare avec l’assentiment d’un père beaucoup plus près de son capital qu’il ne veut le faire paraître.
Pour moi, il y a la scène du viol qui, comme dit plus haut, fait basculer le film jusqu’à son acmé, la scène d’amour, mais la scène la plus cruciale (de croix ? non, je ne vais pas dire cruciale) la scène la plus révélatrice du film est celle de la cuisine. Une cuisine étroite et haute. Zsófia parle pour la première fois et elle dit quoi ? Que son mari, un juif présenté comme très pratiquant, et elle, vont partir faire leur Aliyah en Israël et qu’elle est enceinte. László annonce que Harrison l’a recontacté pour finir le projet. Religion : l’Aliyah. Capitalisme : la construction. La famille : ils sont réunis autour d’un repas. La sexualité : l’enfant annoncé.
Quant à l’étrangeté de la scène finale, elle montre une fin où la nièce silencieuse est devenue une présentatrice de premier plan, où les sombres desseins de Lazlo sont oubliés en même temps que la drogue et Erzsebet, son amour, et cela dans la ville baignée d’eau et à l’architecture improbable, dans la ville qui s’enfonce inexorablement, une de celles où le capitalisme pourrait avoir été révélé en successeur du paternalisme.
The Brutalist ou la brutalité de l’envers de la liberté
Publicité gratuite pour un cinéma local indépendant :
Cinéma Eldorado à Dijon

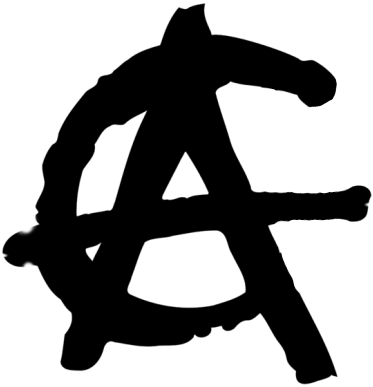


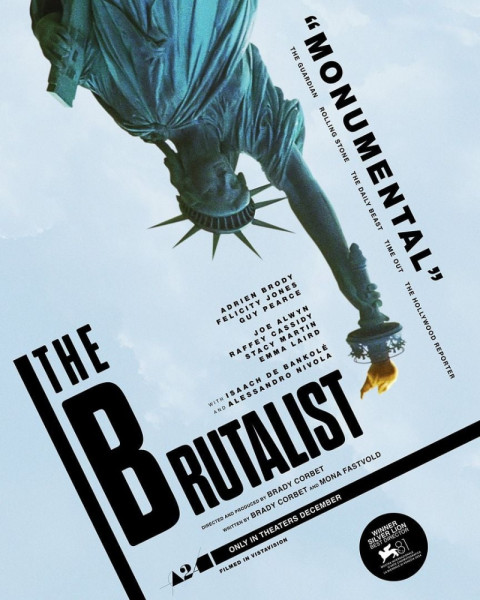
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.