Comme un vide qui se creuse. Comme des patates dans le cœur. Comme une vie qui part en fumée. Des envies de pleurer sans raisons. Des raisons qui s’ignorent. une peau abandonnée sous des tissus synthétiques faits par des machines. des machines conçues pour broyer le vivant. Le vivant qui pleure des larmes dessalées. Des larmes sans goût, dégoûtantes. Des fleuves écœurants de sentimentalismes. Mentalité de pauvres, de losers, de perdants. De père en fils. Ascendant descendant. Je n’en peux parfois plus.
Catégorie : En cours
Divers – En cours
-
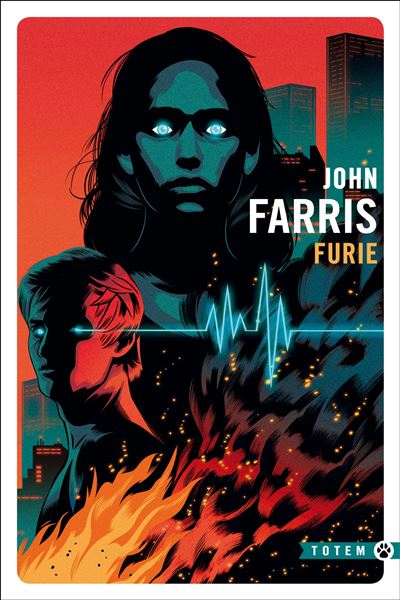
Livre en cours : Fury

commencé le 2025/03/04
pour l’instant je me force mais honnêtement si j’avais un autre roman à lire je le lâcherai sans souci
le 2025/03/15
toujours en cours, à partir du premier tiers les choses s’éclairent. Trop scénarisé à mon goût il est écrit pour faire un film.
le 2025/03/22
terminé, des passages un peu plus « lisible » mais globalement je n’y ai trouvé que peu d’intérêt
-

Erwarterteter Fortschritt *
Version 2
Le ciel est magnifique ce soir, pas un nuage, une lune magnifique, très nette, qui se laisse draguer par une Venus étincelante devant une myriade d’autres étoiles sans doute jalouses du spectacle offert par ces deux stars. À l’abri du vent, il fait doux pour l’époque. damné vent du nord. Il serait presque agréable d’être ici si ce n’était la douleur.
J’ai toujours aimé regarder les étoiles dans le ciel. J’admire le travail fait il y a des milliers d’années pour donner un sens à ce fatras de lumières posées dans un désordre absolu et dans le but avoué d’éduquer ses semblables, qui pour la plupart s’en sont branlé et s’en branlent encore. Moi le premier. Je sais que cela existe, j’en connais quelques histoires, mais ce n’est pas cela qui m’intéresse dans le ciel. J’aime l’idée de l’infini, et c’est dans le ciel que je le vois le mieux. En regardant le ciel, mes pensées se libèrent partiellement : d’où me vient l’amour de l’infini ? Dans un livre, peut-être, mais lequel ? D’un ami, d’une connaissance ? Mais qui ? Du ciel lui-même ? C’est encore le plus plausible, mais difficile d’en être sûr… De ma famille ? Ma femme ? Mes enfants ? Je souris, j’ai essayé de leur apprendre, mais ils se sont toujours moqués de moi, de mes parents ? Non, ils ne pensaient qu’au travail et à l’argent, ce n’était pas facile pour eux, paix à leurs âmes, ni pour mes frères et sœurs. D’un coup, je me rends compte que je suis le dernier de cette génération, et même de la suivante. En remontant le fil du temps, j’oublie l’infini et les étoiles et je repense à la période de mes dix à quinze ans. Un de mes aînés, un arrière-arrière-grand-parent, je crois, habitait en face de chez mes parents. Il était si vieux qu’il ne bougeait plus de son lit et était l’objet d’admiration du village et de disputes de mes parents, de mes oncles et tantes pour savoir qui allait s’en occuper.
Régulièrement, j’avais pour mission de passer voir s’il allait bien, je l’aimais bien, j’aimais bien les histoires qu’il me racontait quand j’étais plus jeune encore. Il avait la fâcheuse habitude de fumer des cigarillos, mais de les fumer à l’envers. Le bout allumé dans la bouche. Il a dû me dire pourquoi, mais j’ai oublié. Mais je me souviens que cela agaçait ma mère, son arrière-petite-bru, qui en détestait l’odeur. Si elle avait su qu’il me demandait de les allumer car il n’arrivait plus à faire fonctionner son briquet à essence et qu’il refusait les briquets à gaz et les allumettes. « Puzza », disait-il en bougonnant et en se pinçant le nez. Je me souviens que j’ai passé des heures à écouter ses histoires jusqu’à l’école secondaire. Cela arrangeait bien ma mère à l’époque : elle n’avait pas à me chercher, elle savait que j’étais la plupart du temps là, à coté du lit gigantesque de mon aïeul, à dessiner, écrire, rêver dans la pénombre et l’odeur des cigarillos. Bon dieu, je me souviens qu’il est mort quelques mois avant ses cent ans. Ce qui avait pourri la fête que la commune envisageait de faire en son honneur. Je revois encore des officiels venir lui crier « tenez bon, l’ancien, nous allons vous faire une belle fête », et lui, pour les agacer, répondait « hein ? » comme s’il était sourd. Nous en riions après leur départ et il me disait : « C’est maintenant que tu dois faire la fête, parce qu’à mon âge, on s’en fout », et mon père : « Allons, papy, cela va être une jolie fête. » Je crois qu’il avait envie, lui aussi, de voir sa famille à l’honneur.
Merde. Je ne dois pas bouger, pas m’agiter, le moindre mouvement me déchire le cerveau. Pourquoi je suis passé par là, je sais pertinemment que c’est plus rapide, mais plus dangereux. Tant pis, rien que d’y penser, je réveille les douleurs. Je dois rêver. Respirer doucement et oublier le présent. Oublier ce corps douloureux. Oublier. Ailleurs. Dans l’univers global. Faire un avec l’environnement. Salut Papy, Je t’ai dépassé de peu, mais je t’ai dépassé. Personne n’a fait la fête pour moi. Le village est abandonné. Et, je vais à la ville le moins souvent possible. J’ai eu 100 ans il y a 4 mois, tu es parti quelques mois avant les tiens. Mais, quand même, je pense que j’aurais pu exploser ton score, si je n’avais pas voulu faire le fou en passant par les passages des 3 sources. Je sais qu’il est glissant. Mais cela fait presque deux mois qu’il fait gris, moche et humide, j’ai bien cru que j’allais y passer, mais depuis deux jours, les nuages ont été balayés par le vent du nord, ce maudit vent du nord qui efface les nuages, créant l’illusion du printemps, mais qui gèle tout ce qu’il touche. Ce matin, j’ai eu le courage d’aller voir si je trouvais des champignons dans la forêt qui se trouve derrière le passage. Ce n’est pas si loin et je peux encore y aller en faisant le tour, mais, en revenant avec mon panier de champignons, j’ai eu envie de voir l’état des trois sources : L’eau de celle qui traverse le chemin a le goût de la pierre, un goût minéral. Merci. Papy C’est toi qui me l’avait fait remarquer antan. Je n’étais pas venu depuis des années et j’aurais pu m’en passer encore aujourd’hui. Aïe, pas de regret ; respire, calme : l’eau t’a fait le plus grand bien. Tu le sens, le sac de champignon ? C’est bien lui qui est posé sous ton bras… Doucement, prends-en un et mâche-le doucement. Ahhhh quelle douleur atroce. Mais bordel, je vais sans doute crever ici, autant me faire plaisir. Le goût du champignon, ce goût de terre, ce mousse. La nature, c’est elle qui m’a fait tenir ces dernières années. Elle et les quelques marcheurs qui se perdaient et traversaient le village étaient étonnés de trouver quelqu’un encore debout. Je dois être dans des albums de photos du monde entier. Sourire. Plus jeune, j’en ai fait des tours sur notre monde. Je suis fier de ma vie, j’ai passé mes vingt premières et vingt dernières années ici. J’en suis le produit ultime. J’ai peu de chances que l’on me trouve avant quelques mois, et qu’est -ce que cela change, ici ou ailleurs ? J’espère juste ne pas trop souffrir. Petit à petit, mon corps va se mêler à la terre et ainsi je lui rendrai un peu de ce qu’elle m’a apporté. Je ne regrette rien, ma femme est morte un peu avant mes enfants. Puis j’ai vu partir la plupart de mes petits-enfants, puis j’ai décidé de revenir ici. Parfois, un de mes arrière-petits-enfants se rappelle de moi, mais nous sommes des inconnus les uns pour les autres… J’espère qu’ils sont heureux. Moi, je le suis même maintenant où le moindre mouvement est une souffrance. Je n’avais pas fait attention, mais la nuit est tombée, et la lune s’est levée, accompagnée de Vénus. Je me plonge dans l’espace en mâchouillant des champignons, les arbres autour coupent le vent, la terre est exceptionnellement chaude, une chouette hulule au loin, les branches craquent et j’alterne entre rêve et réalité, les champignons sont un miracle.
Je suis à Buenos Aires juste après la guerre, j’habite la maison d’un cordonnier, Attila, qui m’héberge et m’apprend le métier, je suis arrivé ici par un énorme cargo en tant que marin.
Après la guerre, la tête pleine d’horreurs, j’étais retourné dans mon village, j’étais perdu. En Espagne, la dictature était restée en place et nos horizons étaient étroits. À la ville voisine, un pêcheur avait besoin d’un commis. Je lui plus, nous partîmes avec son équipe faire des pêches lointaines. Un jour dans un port français, j’entendis parler d’un cargo qui recrutait un aide-cuisinier pour aller en Argentine. Je ne connaissais pas réellement, mais le nom faisait rêver. Ils m’engagèrent. Les adieux avec mon patron furent l’occasion d’une beuverie de marin mémorable, je fis le premier jour de voyage dans le coma. Les voyages en cargo sont longs, monotones et encore plus longs. J’ai épluché tellement de légumes, ouvert tellement de boîtes, mais déjà le soir et le ciel, les pauses et l’océan, les baleines, les dauphins et autres animaux que je ne connaissais pas me fascinaient. Le voyage devait durer trois semaines, mais, suite à une avarie, nous restâmes cinq semaines en mer. Et le seul divertissement de l’équipe était les combats. Pas de gros gabarits, mais des vicieux, des nerveux. J’ai perdu deux dents et je porte encore une cicatrice à l’arcade. J’ai appris à me battre sur le bateau et pendant les vingt ans qui ont suivi, j’ai gagné quelques combats, mais j’en ai perdu aussi beaucoup. La vie était simple. je me levais tôt, je vérifiais mes blessures, j’allais à la cambuse, À la pause de l’après-midi, je me posais sur le pont avant de retourner à la cambuse ; puis, le soir, une fois le local propre, je passais me changer et nous nous retrouvions sur le pont pour picoler et nous battre. Quand il pleuvait, ce qui était rare, nous jouions aux cartes. Perso, je préférais aller lire dans ma chambre. Je me suis endurci en peu de temps. J’ai oublié ma Gallice et la guerre en entamant ma nouvelle vie. Mais je fus soulagé d’arriver à Buenos Aires, le manque de femmes commençait à rendre les marins violents et en même temps mélancoliques. Les deux semaines supplémentaires commençaient à nous marquer. Je pris ma paye et je m’enfonçai dans la ville, jusqu’à un quartier populaire où je trouvai facilement un petit logement. Et je bus, je bus pendant un mois, je passais de bar en bar, de bagarre en bagarre et de femme en femme, et le tout en jouant, en riant et en me moquant de la vie et des gens sérieux. J’étais jeune et les marques des coups plaisaient. Un soir plus violent qu’un autre, j’avais dû en agacer un ou m’attacher à celle qu’il ne fallait pas, je pris un mauvais coup et je sombrai dans le néant. Il me transportèrent je ne sais comment et me balancèrent ou ils purent. Je me réveillai quelques jours plus tard dans une chambre chez Attila, le cordonnier, dans un quartier aux confins de la ville. Ses filles m’avaient trouvé sur le trottoir devant la boutique en allant à l’école. Ne sachant pas quoi faire de moi, ils me montèrent avec difficulté dans la chambre et, avec l’aide d’un médecin, ils me soignèrent. Une dizaine de après, je fus sur pied et une nouvelle vie pouvait commencer pour moi.
Version 1 le 04/05/2025

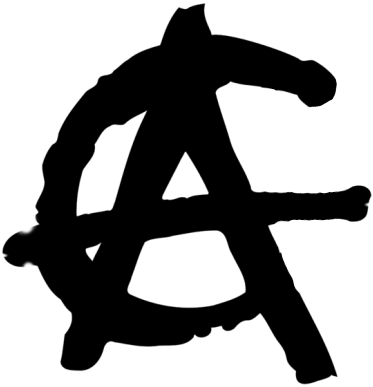
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.